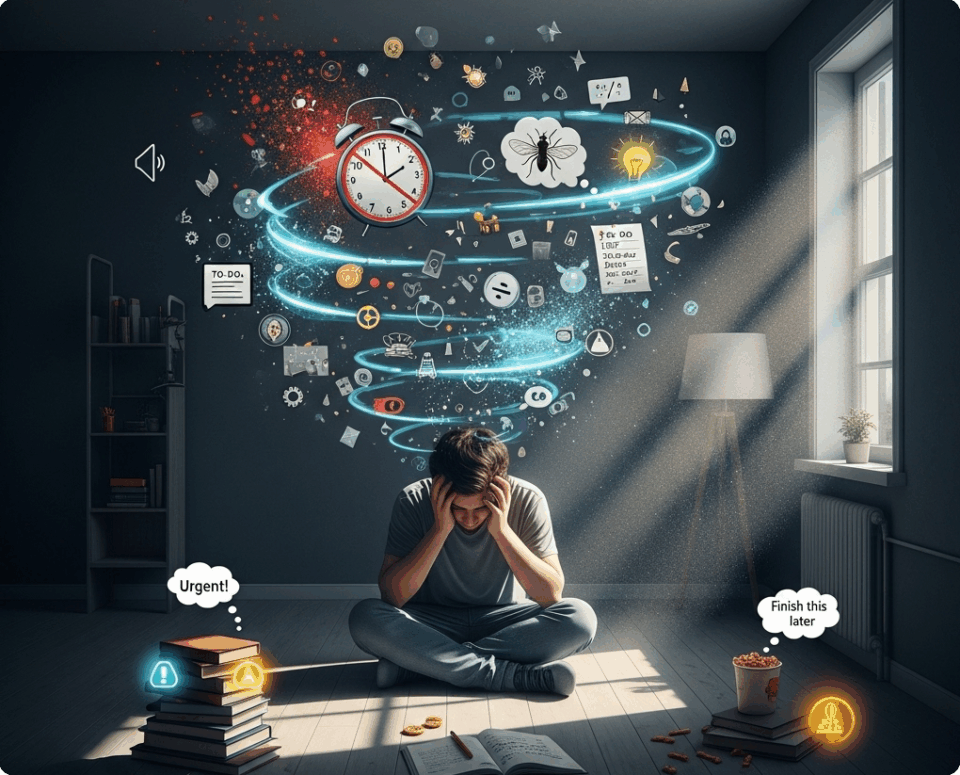Ces dernières années, la recherche sur le trouble du déficit de l’attention/hyperactivité (TDAH) a progressé et s’est enrichie. Les scientifiques découvrent que le TDAH influence bien plus que l’attention et le comportement. Des expériences sexuelles et de la créativité à la structure cérébrale et même à l’espérance de vie, de nouvelles découvertes offrent une compréhension plus approfondie et plus nuancée de ce que signifie vivre avec ce trouble.
Le TDAH est un trouble neurodéveloppemental caractérisé par des schémas persistants d’inattention, d’hyperactivité et d’impulsivité, des symptômes qui peuvent perturber la vie quotidienne à l’école, au travail et dans les relations sociales. Bien qu’il débute généralement dès l’enfance, un nombre important de cas persistent à l’adolescence et à l’âge adulte.
Ce trouble est généralement classé en trois manifestations : inattention prédominante (anciennement appelé TDA), hyperactivité-impulsivité prédominante et combinaison des deux. Les personnes atteintes de TDAH peuvent avoir des difficultés à maintenir leur concentration, à gérer leur temps, à résister aux distractions ou à contrôler leurs impulsions. Bien que les stimulants comme le méthylphénidate restent un traitement de base, les chercheurs étudient de plus en plus les approches non pharmacologiques, les mécanismes biologiques sous-jacents et les dimensions sociales et émotionnelles plus larges du trouble.
Lisez la suite pour découvrir 12 études récentes qui mettent en évidence l’ampleur surprenante de l’impact du TDAH.
1. Les adultes atteints de TDAH utilisent souvent de la musique stimulante pour gérer leur attention
Une étude publiée dans Frontiers in Psychology a révélé que les jeunes adultes présentant un TDAH ont tendance à écouter de la musique de fond plus fréquemment que leurs pairs neurotypiques, notamment lorsqu’ils étudient ou font de l’exercice. Ces personnes préfèrent également une musique plus stimulante, quelle que soit l’activité. Cela suggère que la musique pourrait être utilisée comme une forme d’autorégulation, contribuant potentiellement à contrer la sous-excitation associée au TDAH.
L’étude, basée sur des données d’enquête auprès de plus de 400 participants, soutient le modèle d’éveil cérébral modéré, selon lequel les personnes atteintes de TDAH recherchent souvent une stimulation externe pour maintenir leur concentration. Bien que les groupes TDAH et non TDAH aient tous deux rapporté que la musique améliorait leur humeur et leur concentration, seul le groupe TDAH a montré une utilisation significativement plus élevée de la musique lors des tâches quotidiennes. Les chercheurs soulignent que la musique pourrait constituer un outil accessible et intuitif pour aider les personnes atteintes de TDAH à gérer les exigences attentionnelles au quotidien.
2. Les femmes présentant des symptômes de TDAH inattentifs signalent des orgasmes moins réguliers
Dans le Journal of Sex Research , des scientifiques ont constaté que les femmes présentant principalement des symptômes de TDAH inattentifs rapportaient une moindre régularité orgasmique lors des rapports sexuels entre partenaires. Ce phénomène pourrait être lié à des difficultés à rester concentré et présent pendant l’activité sexuelle, un défi que le TDAH inattentif peut exacerber. En revanche, les femmes présentant des symptômes d’hyperactivité-impulsivité rapportaient une régularité orgasmique légèrement supérieure.
À partir des données de plus de 800 femmes cisgenres, les chercheurs ont constaté que la satisfaction et la confiance sexuelles peuvent être influencées par des processus cognitifs et attentionnels. Les médicaments contre le TDAH semblent corrélés à une meilleure fonction sexuelle, bien que l’étude n’ait pas permis d’établir de lien de causalité. Ces résultats soulignent la nécessité de mieux comprendre l’influence de la neurodivergence sur les expériences intimes, en particulier chez les femmes souvent sous-diagnostiquées ou mal diagnostiquées.
3. L’utilisation à long terme de stimulants est liée à des différences de structure cérébrale dans le TDAH
Une étude de neuroimagerie publiée dans la revue Psychiatry Research: Neuroimaging a comparé des adultes atteints de TDAH ayant pris des psychostimulants à ceux n’en ayant jamais reçu. Les personnes ayant des antécédents de prise de médicaments présentaient une plus grande complexité de la surface cérébrale, notamment une augmentation du repliement cortical (gyrification) et de la profondeur des sillons dans les régions impliquées dans la régulation des émotions et la récompense.
Il est intéressant de noter que ces différences structurelles ne se sont pas accompagnées de meilleurs résultats cliniques. La gravité des symptômes et les scores d’impulsivité sont restés similaires dans les deux groupes. Cela suggère que, si les stimulants peuvent influencer la morphologie cérébrale, ces changements ne se traduisent pas nécessairement par une amélioration du fonctionnement. La petite taille de l’échantillon de l’étude limite la généralisation, mais les résultats soulèvent d’importantes questions sur l’impact des médicaments à long terme sur le cerveau des adultes atteints de TDAH.
4. Les probiotiques peuvent réduire l’hyperactivité chez les jeunes enfants atteints de TDAH
Un essai contrôlé randomisé publié dans la revue Research on Child and Adolescent Psychopathology a testé l’efficacité des probiotiques pour réduire les symptômes du TDAH et de l’autisme. Les chercheurs ont constaté qu’un traitement de 12 semaines avec deux souches de probiotiques était associé à une diminution des scores d’hyperactivité et d’impulsivité chez les enfants de 5 à 9 ans. Cet effet était particulièrement marqué chez les enfants autistes présentant également des symptômes de TDAH.
Bien que l’amélioration globale des symptômes ait été modeste dans toutes les tranches d’âge, les enfants plus jeunes du groupe probiotique ont montré des améliorations comportementales significatives. Ces premiers résultats confirment l’intérêt croissant pour l’axe intestin-cerveau et suggèrent que les interventions ciblant le microbiome pourraient offrir un soutien complémentaire aux enfants présentant des troubles du développement neurologique. Des études plus vastes et plus longues sont nécessaires pour confirmer la durabilité et les mécanismes de ces effets.
5. Les adolescents peuvent sous-déclarer les symptômes du TDAH par rapport aux filles
Dans une étude publiée dans le Journal of Psychiatric Research , des chercheurs suédois ont constaté que les adolescents atteints de TDAH avaient tendance à sous-estimer leurs symptômes par rapport aux évaluations de leurs parents et de leurs cliniciens. En revanche, les auto-évaluations des filles étaient plus cohérentes avec les évaluations externes. Globalement, les auto-évaluations des adolescents correspondaient davantage à celles des cliniciens qu’à celles de leurs parents.
Ces résultats suggèrent que les garçons seraient moins conscients de leurs symptômes – ou moins enclins à les signaler – tandis que les filles seraient plus conscientes d’elles-mêmes ou plus ouvertes. Ces résultats soulignent l’importance d’intégrer plusieurs informateurs lors du processus diagnostique et de veiller à ce que la voix des adolescents soit prise en compte, en particulier lorsque les différences entre les sexes peuvent influencer l’expression des symptômes.
6. La créativité dans l’autisme peut en fait refléter un TDAH concomitant
Une vaste étude publiée dans le Journal of Psychopathology and Clinical Science a remis en question l’idée reçue selon laquelle l’autisme serait associé à une créativité accrue. Après avoir contrôlé le TDAH et les capacités cognitives, les chercheurs ont constaté que les adultes autistes n’étaient pas plus créatifs que les adultes non autistes lors de tâches de laboratoire. En revanche, les personnes atteintes de TDAH concomitantes présentaient des réalisations et des comportements plus créatifs.
Les résultats suggèrent que la créativité pourrait être plus étroitement liée aux traits du TDAH – comme l’impulsivité et la flexibilité de pensée – qu’à l’autisme lui-même. Cela remet en question les stéréotypes sur la « créativité autistique » et indique que les programmes éducatifs et cliniques devraient adapter le soutien au profil cognitif unique de chaque individu, plutôt que de présumer des points forts sur la seule base du diagnostic.
7. Un médicament contre l’hypertension artérielle s’avère prometteur comme traitement non stimulant du TDAH
Dans une étude publiée dans Neuropsychopharmacology , des chercheurs ont identifié l’amlodipine, un médicament courant contre l’hypertension artérielle, comme un traitement potentiel du TDAH. À l’aide de modèles animaux et d’analyses génétiques, ils ont constaté que l’amlodipine réduisait l’hyperactivité et l’impulsivité chez des rats et des poissons-zèbres élevés pour imiter des traits similaires au TDAH. Le médicament semblait également influencer l’activité cérébrale dans les zones associées à l’attention et au contrôle des impulsions.
Ces résultats sont remarquables car l’amlodipine cible les canaux calciques de type L, de plus en plus impliqués dans les troubles psychiatriques. L’équipe de recherche a confirmé que le médicament traverse la barrière hémato-encéphalique et a suggéré que son mécanisme d’action pourrait offrir une alternative plus sûre et non stimulante aux médicaments traditionnels contre le TDAH. Des essais cliniques chez l’homme sont encore nécessaires, mais cette stratégie de réorientation pourrait offrir de nouvelles pistes thérapeutiques aux personnes qui ne répondent pas bien aux médicaments actuels.
8. Les résultats à long terme pour les adultes atteints de TDAH restent difficiles, même avec des médicaments
Une étude populationnelle menée au Danemark, publiée dans le Journal of Psychiatric Research , a suivi près de 5 000 personnes diagnostiquées avec un TDAH et a constaté qu’à 30 ans, leurs résultats étaient nettement inférieurs à ceux de leurs pairs en matière d’éducation, d’emploi et de santé mentale. Malgré l’observance du traitement médicamenteux prescrit par de nombreux participants pendant dix ans, les résultats tels que l’accès à l’emploi et l’obtention d’un diplôme d’études supérieures ne se sont pas améliorés de manière significative.
Les adultes atteints de TDAH étaient plus susceptibles de vivre seuls, de dépendre de l’aide sociale et de souffrir de troubles psychiatriques concomitants. L’observance du traitement médicamenteux n’était pas prédictive de meilleurs résultats scolaires ou professionnels, ce qui suggère que le traitement pharmacologique seul pourrait ne pas suffire à relever les défis plus larges liés au TDAH. Les facteurs socio-économiques, comme le niveau d’éducation des parents, étaient davantage prédictifs de réussite, soulignant l’importance d’interventions globales à plusieurs niveaux.
9. L’imagerie cérébrale révèle comment les adultes atteints de TDAH anticipent différemment les décisions risquées
Une étude de neuroimagerie publiée dans Brain and Behavior a examiné la façon dont les adultes atteints de TDAH appréhendent les décisions risquées avant de les prendre. Les participants ont réalisé une tâche impliquant risque et récompense (la tâche de risque analogique du ballon) tout en subissant des examens IRMf. Les chercheurs ont constaté que les personnes atteintes de TDAH présentaient une activation réduite des régions cérébrales liées à la conscience de soi et au traitement émotionnel pendant la phase d’anticipation, avant la prise de décision.
Il est intéressant de noter que les femmes atteintes de TDAH ont montré une activation plus importante de plusieurs régions cérébrales régulatrices que les hommes, suggérant de possibles différences liées au sexe dans les mécanismes compensatoires. Ces différences neuronales ne se sont pas traduites par des différences comportementales manifestes lors de la tâche, ce qui indique que les personnes atteintes de TDAH peuvent prendre les mêmes décisions que les autres, mais par des processus internes différents. L’étude étaye des théories comme l’hypothèse des marqueurs somatiques, qui souligne le rôle des signaux corporels et émotionnels dans la prise de décision.
10. Les adultes atteints de TDAH ont une espérance de vie plus courte, en particulier les femmes.
Une vaste étude de cohorte menée au Royaume-Uni, publiée dans le British Journal of Psychiatry , a révélé que les adultes diagnostiqués avec un TDAH ont une espérance de vie significativement plus courte que ceux qui n’en souffrent pas. En moyenne, les hommes atteints de TDAH ont perdu entre 4,5 et 9 ans de vie, tandis que les femmes ont perdu entre 6,5 et 11 ans. Ces chiffres sont ajustés en fonction de l’état de santé initial et de facteurs démographiques.
Les chercheurs attribuent cet écart à une combinaison de facteurs : des taux plus élevés de problèmes de santé physique et mentale, un risque accru de toxicomanie et des désavantages sociaux tels que le chômage et un accès limité aux soins de santé. Le TDAH en lui-même ne réduit peut-être pas directement l’espérance de vie, mais ses effets peuvent s’aggraver avec le temps par des mécanismes évitables. Ces résultats soulignent la nécessité de changements systémiques dans l’accès aux soins de santé et d’interventions de santé publique adaptées aux personnes atteintes de TDAH.
11. Les personnes présentant des symptômes de TDAH éprouvent davantage de souvenirs involontaires
Une étude publiée dans le British Journal of Psychology a révélé que les personnes présentant des symptômes de TDAH ont tendance à ressentir plus fréquemment des souvenirs involontaires au quotidien. Ces souvenirs spontanés, qui surgissent sans intention, ont également été jugés moins positifs et plus répétitifs que ceux rapportés par les personnes ne présentant pas de symptômes de TDAH.
Les chercheurs ont mené une tâche de vigilance en laboratoire et une étude journalière de 48 heures. Si la tâche en laboratoire n’a montré aucune différence entre les groupes, les données du journal ont révélé que les personnes présentant des symptômes de TDAH rapportaient près de deux fois plus de souvenirs spontanés. Cela suggère que les expériences de laboratoire contrôlées pourraient ne pas saisir pleinement l’ampleur des différences d’attention et de mémoire observées au quotidien. Ces résultats pourraient éclairer la manière dont le TDAH affecte non seulement l’attention, mais aussi la mémoire et le traitement des émotions.
12. Le TDAH et la dyslexie partagent un fort chevauchement génétique
Dans une étude génétique à grande échelle publiée dans Molecular Psychiatry , des chercheurs ont découvert que le TDAH et la dyslexie partagent un nombre important de facteurs de risque génétiques. À partir des données de millions de participants, l’étude a identifié un groupe génétique distinct reliant les deux affections et a mis au jour 49 régions génomiques associées aux deux traits, dont 43 n’avaient pas été identifiées auparavant.
Ce facteur commun « troubles de l’attention et de l’apprentissage » se distinguait d’autres traits neurodéveloppementaux comme l’autisme. Les résultats suggèrent que le TDAH pourrait avoir davantage de points communs génétiques avec la dyslexie qu’avec l’autisme, malgré la cooccurrence fréquente de ces trois troubles. Plusieurs gènes identifiés lors de l’analyse, tels que SORCS3 et AMT, sont impliqués dans le développement cérébral, l’apprentissage et la mémoire. Ces résultats offrent un nouvel éclairage sur les bases biologiques des troubles de l’apprentissage et de l’attention et pourraient orienter les recherches futures sur les approches éducatives et thérapeutiques personnalisées.